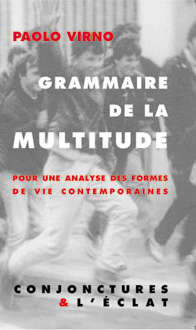 |
Paolo Virno Grammaire de la multitude |
|
|
|
Quatrième journée : Dix thèses sur la multitude et le capitalisme post-fordiste |
|
J'ai essayé de décrire le mode de production contemporain, ce que l'on appelle le post-fordisme, sur la base de catégories tirées de la philosophie politique, de l'éthique, de l'épistémologie et de la philosophie du langage. Non pas par coquetterie professionnelle, mais parce que je suis véritablement convaincu que le mode de production contemporain exige, pour être décrit de façon adéquate, cette instrumentation, ces perspectives larges. On ne comprend pas le post-fordisme si on n'a pas recours à une constellation conceptuelle éthico-linguistique. C'est d'autant plus évident, du reste, quand le matter of fact consiste en l'identification progressive entre poiésis et langage, production et communication. Pour désigner d'un seul terme les formes de vie et les jeux de langage qui caractérisent notre époque, j'ai utilisé la notion de «multitude». Cette notion, aux antipodes de celle de «peuple», se définit par l'ensemble des ruptures, des déplacements et des innovations que j'ai cherché à signaler. Citons en vrac: la vie en tant qu'étranger (bios xenikos) comme condition ordinaire; la prédominance des «lieux communs» du discours sur les discours «spécifiques»; le caractère public de l'intellect, aussi bien en tant que ressource apotropaïque que comme pilier de la production sociale; l'activité sans œuvre (c'est-à-dire la virtuosité); la centralité du principe d'individuation; la relation avec le possible en tant que possible (opportunisme); le développement hypertrophique des aspects non référentiels du langage (bavardage). Dans la multitude, on a la pleine exhibition historique, phénoménique, empirique de la condition ontologique de l'animal humain: dénuement biologique, caractère indéfini ou potentiel de son existence, absence d'un milieu déterminé, intellect linguistique comme «compensation»…de la pénurie d'instincts spécialisés. C'est comme si la racine était apparue à la surface, se montrant enfin à l'œil nu. Ce qui a toujours été vrai n'apparaît qu'aujourd'hui débarrassé de ses voiles. La multitude: une configuration biologique fondamentale qui devient manière d'être historiquement déterminée, ontologie qui se révèle comme phénomène. On pourrait dire aussi que la multitude post-fordiste met en relief sur le plan historico-empirique l'aaopogenèse comme telle, c'est-à-dire la genèse même de l'animal humain, ses caractères différentiels. Elle la résume en entier, elle la récapitule. Si on y pense, ces considérations plutôt abstraites ne sont qu'une autre façon de dire que la principale ressource productive du capitalisme contemporain, ce sont les attitudes linguistico-relationnelles de l'être humain, l'ensemble des facultés (dynameis, puissance) communicatives et cognitives qui le caractérisent. Le séminaire touche à sa fin. Ce que l'on pouvait dire a été (bien ou mal) dit. Maintenant, à l'issue de cette navigation autour du continent «multitude», il ne reste plus qu'à insister sur quelques aspects importants. C'est à cette fin que je vous propose dix assertions sur la multitude et le capitalisme post-fordiste. Des assertions que j'appelle thèses par simple commodité. Elles ne prétendent pas à l'exhaustivité, elle n'entendent pas s'opposer à d'autres analyses ou définitions possibles du post-fordisme. Elles n'ont guère que l'aspect apodictique et (j'espère) la concision des véritables thèses. Certaines de ces assertions auraient peut-être pu se recouper entre elles, pour constituer une thèse unique. Par ailleurs leur séquence est parfois arbitraire: ce qui est présenté comme la «thèse x» ne perdrait pas grand-chose à être présentée comme la «thèse y» (et vice-versa). Il doit être clair, pour finir, que j'affirme souvent ou qu'il m'arrive de nier avec plus de netteté ou moins de nuances qu'il serait juste (et prudent) de le faire. Dans certains cas, je dirai plus que ce que je pense.
Thèse 1 Le post-fordisme (et avec lui la multitude) est apparu, en Italie, avec les luttes sociales que l'on a l'habitude de désigner comme le «mouvement de 1977». Le post-fordisme, en Italie, a commencé avec les tumultes d'une force de travail scolarisée, précaire, mobile, qui se prit de haine pour l'éthique du travail et s'opposa, parfois de front, à la tradition et à la culture de la gauche historique, marquant une rupture claire par rapport à l'ouvrier de la chaîne de montage, à ses us et coutumes, à ses formes de vie. Le post-fordisme en Italie a commencé par des conflits centrés sur des figures sociales qui, en dépit de leur apparente marginalité, allaient devenir le véritable pivot du nouveau cycle de développement du capitalisme. Du reste, il est arrivé en d'autres occasions qu'un changement radical du mode de production soit précédé par la conflictualité des couches de la force de travail qui constitueraient par la suite l'axe porteur de la production de plus-value. Il suffit de penser au danger que constituaient aux yeux des autres, au XVIIIe siècle, les vagabonds anglais, déjà expulsés des champs et sur le point d'entrer dans les premières manufactures. Ou de penser aux luttes des ouvriers déqualifiés aux Etats-Unis dans les années 1910, luttes qui précédèrent la transformation fordiste et tayloriste, précisément fondée sur la déqualification systématique du travail. Toute métamorphose drastique de l'organisation du travail est destinée par principe à réévoquer les malheurs de l'«accumulation originelle», en devant encore transformer un rapport entre les choses (les nouvelles technologies, une répartition différente des investissements, etc.) en rapport social. C'est justement dans cet intermède délicat que se manifeste parfois le revers subjectif de ce qui devient plus tard le cours inexorable des choses. Le chef-d'œuvre du capitalisme italien, c'est justement d'avoir transformé en ressource productive les comportements qui, de prime abord, s'étaient manifestés sous les apparences du conflit radical. La conversion des propensions collectives du mouvement de 77 – exode de l'usine, désaffection du poste fixe, familiarité avec les savoirs et les réseaux de la communication – en un concept renouvelé de professionnalisme (opportunisme, bavardage, virtuosité, etc.): voilà le résultat le plus précieux de la contre-révolution italienne (si l'on entend par contre-révolution non pas la simple restauration de l'état des choses antérieur, mais, littéralement, une révolution à l'envers, c'est-à-dire le renouveau drastique de l'économie et des institutions afin de relancer la productivité et la domination politique). Le mouvement de 77 eut la mauvaise fortune d'être traité comme un mouvement de marginaux et de parasites. Mais qualifier le mouvement de marginal et de parasite, c'était le point de vue de ceux qui agitaient de telles accusations. De ceux, en fait, qui s'identifiaient complètement au paradigme fordiste, considérant que seul était «central» et «productif» le poste fixe dans une usine de biens de consommation durables. Ils s'identifiaient donc avec le cycle de développement désormais sur le déclin. Tout bien considéré, le mouvement de 77 préfigura certains traits de la multitude post-fordiste. Toute blafarde et grossière qu'elle fût, sa virtuosité n'en fut pas moins non servile.
Thèse 2 Le post-fordisme est la réalisation empirique du «Fragment sur les machines» de Marx. Marx écrit: «Le vol du temps de travail d'autrui, sur quoi repose la richesse actuelle, apparaît comme une base misérable comparée à celle, nouvellement développée, qui a été créée par la grande industrie elle-même. Dès lors que le travail sous sa forme immédiate a cessé d'être la grande source de la richesse, le temps de travail cesse nécessairement d'être sa mesure et, par suite, la valeur d'échange d'être la mesure de la valeur d'usage» (Marx 1939-1941 post.). Dans le «Fragment sur les machines» des Grundrisse dont j'ai extrait cette citation, Marx soutient une thèse bien peu marxiste: le savoir abstrait – le savoir scientifique en premier lieu, mais pas seulement lui – est en passe de devenir rien de moins que la principale force productive, reléguant le travail parcellarisé et répétitif à une position résiduelle. On sait que Marx a recours à une image assez suggestive pour désigner l'ensemble des connaissances qui constituent l'épicentre de la production sociale et, ensemble, ordonnent tous les milieux de vie: le general intellect, l'intellect général. La prééminence tendancielle du savoir fait du temps de travail une «base misérable». Ce que l'on appelle la «loi de la valeur» (selon laquelle la valeur d'une marchandise est déterminée par le temps de travail qui est incorporé en elle), que Marx considère comme la clef de voûte des rapports sociaux actuels, est cependant effritée et réfutée par le développement du capitalisme même. C'est là que Marx anticipe une hypothèse de dépassement du rapport de production dominant très différente de celles, plus connues, qu'il expose dans d'autres textes. Dans le «Fragment», la crise du capitalisme n'est plus attribuée aux disproportions inhérentes à un mode de production fondé réellement sur le temps de travail consacré par les individus (elle n'est donc plus attribuée aux déséquilibres reliés à la pleine vigueur de la loi de la valeur, par exemple à la chute du taux de profit). Vient plutôt au premier plan la contradiction déchirante entre un processus de production qui désormais se sert directement et exclusivement de la science comme levier, et une unité de mesure de la richesse qui coïncide encore avec la quantité de travail incorporée dans les produits. S'éloigner progressivement de cet étau conduit, selon Marx, à «l'effondrement de la production fondée sur la valeur d'échange», et donc au communisme. Ce qui saute aux yeux à l'époque post-fordiste, c'est la pleine réalisation dans les faits de la tendance décrite par Marx, sans pour autant aucune contrepartie d'émancipation. Au lieu d'être un foyer de crise, la disproportion entre le rôle assumé par le savoir et l'importance déclinante du temps de travail a donné lieu à des formes de domination nouvelles et stables. La métamorphose radicale du concept de production même s'est encore inscrite dans le contexte du travail pour un patron. Le «Fragment» fait plus qu'évoquer un dépassement de ce qui existe, il constitue une boîte à outils pour le sociologue. Il décrit une réalité empirique que tout le monde a sous les yeux: la réalité empirique de l'ordre post-fordiste.
Thèse 3 La multitude reflète en elle-même la crise de la société du travail. La crise de la société du travail ne coïncide certainement pas avec une diminution linéaire du temps de travail. Celui-ci démontre même une tendance inédite à tout envahir. Les positions de Gorz et de Rifkin sur la «fin du travail» (Gorz 1997; Rifkin 1995) sont erronées; elles engendrent des malentendus de toutes sortes; et ce qui est pire, elles empêchent d'y voir clair sur la question qu'elles évoquent pourtant. La crise de la société du travail consiste plutôt dans le fait (comme nous le disons à la thèse 2) que la richesse sociale est produite par la science, par le general intellect, et non plus par le travail effectué par les individus. Il semble que le travail dépendant puisse être ramené à une portion presque négligeable de la vie. La science, l'information, le savoir en général, la coopération se présentent comme les piliers de la production. Ce sont eux qui sont importants et non plus le temps de travail. Toutefois ce temps continue de valoir comme paramètre de la richesse et du développement sociaux. Dépasser la société du travail constitue donc un processus contradictoire, théâtre de furieuses antinomies et de paradoxes déconcertants. Le temps de travail est l'unité de mesure en vigueur, mais elle n'est plus vraie. Ignorer l'un des deux aspects – c'est-à-dire souligner seulement le fait qu'elle est en vigueur ou seulement le fait qu'elle n'est pas vraie – ne mène pas très loin: dans le premier cas, on ne s'aperçoit même pas de la crise de la société du travail, et dans le second on finit par avaliser des représentations iréniques à la Gorz ou à la Rifkin. Le dépassement de la société du travail se produit dans les formes prescrites par le système social fondé sur le travail salarié. Avoir trop de temps, ce qui représente une richesse potentielle, se manifeste comme une misère: aide sociale, chômage structurel (provoqué par les investissements et non par leur absence), flexibilité illimitée de l'emploi de la force de travail, prolifération des hiérarchies, retour d'archaïsmes disciplinaires pour contrôler les individus qui ne sont plus soumis aux préceptes du système de l'usine. C'est là la tempête magnétique qui accompagne, sur le plan phénoménique, le déploiement d'un «dépassement» si paradoxal qu'il s'accomplit sur la base même de ce qui serait à dépasser. Je reprends la phrase-clé: le dépassement de la société du travail s'accomplit dans l'obtempération aux règles du travail salarié. Cette phrase ne fait qu'appliquer à la situation post-fordiste ce que Marx avait observé à propos des premières sociétés par actions. Selon Marx, avec les sociétés par actions, on a le «dépassement de la propriété privée sur la base même de la propriété privée». Ce qui revient à dire: les sociétés par actions attestent de la possibilité de déborder le régime de la propriété privée, mais cette attestation a lieu, encore et toujours, à l'intérieur de la propriété privée et, même, renforce considérablement cette dernière. Toute la difficulté, dans le cas du post-fordisme comme déjà dans celui des sociétés par actions, c'est de considérer simultanément les deux profils contradictoires, c'est-à-dire la subsistance et la fin, la validité et le dépassement possible. La crise de la société du travail (si on la conçoit correctement) implique que la force de travail post-fordiste peut être décrite avec les catégories dont Marx s'est servi pour analyser l'«armée industrielle de réserve», c'est-à-dire le chômage. Marx pensait qu'on pouvait diviser l'«armée industrielle de réserve» en trois espèces ou figures: le fluide (aujourd'hui on parlerait du turn-over, des retraites anticipées, etc.), le latent (là où l'innovation technologique peut intervenir n'importe quand pour décimer l'emploi), le stagnant (en termes actuels: le travail au noir, précaire, atypique). Selon Marx, la masse des chômeurs est fluide, latente ou stagnante, mais ce n'est certainement pas le cas de la classe ouvrière qui a un emploi; il s'agit d'une partie marginale de la force de travail, mais pas de la partie centrale. Or, la crise de la société du travail (avec les caractères que j'ai essayé d'esquisser plus haut) fait en sorte que ces trois déterminations s'appliquent, effectivement, à la totalité de la force de travail. La classe ouvrière en tant que telle est fluide, latente ou stagnante. Chaque prestation de travail salarié laisse transparaître sa non-nécessité, son aspect de coût social excessif. Mais cette non-nécessité se manifeste encore et toujours comme la perpétuation du travail salarié, sous formes précaires ou «flexibles».
Thèse 4 Pour la multitude post-fordiste, disparaît toute différence qualitative entre temps de travail et temps de non-travail. Le temps social, aujourd'hui, semble déréglé parce qu'il n'y a plus rien qui distingue le travail du reste de l'activité humaine. Donc, parce que le travail cesse de constituer une praxis particulière et séparée, à l'intérieur de laquelle sont en vigueur des critères et des procédures spécifiques, très différents des critères et des procédures qui règlent le temps de non-travail. Il n'y a plus un seuil net, bien défini, qui sépare temps de travail et temps de non-travail. Dans le fordisme, selon Gramsci, l'intellect reste en dehors de la production; c'est seulement une fois le travail accompli que l'ouvrier lit le journal, se rend à la section du parti, pense, dialogue. En revanche, dans le post-fordisme, puisque la «vie de l'esprit» est incluse pleinement dans l'espace-temps de la production, c'est une homogénéité essentielle qui prévaut. Travail et non-travail développent une productivité identique, fondée sur l'exercice de facultés humaines génériques: le langage, la mémoire, la socialité, les inclinations éthiques et esthétiques, la capacité d'abstraction et d'apprentissage. Du point de vue du «qu'est-ce qu'on fait ?» et du «comment le fait-on ?», il n'y a pas de différence substantielle entre travail et chômage. On en vient à dire: le chômage, c'est du travail non rémunéré; le travail, quant à lui, c'est du chômage rémunéré. On peut soutenir avec quelque raison que si, d'un côté, on ne s'arrête jamais de travailler, d'un autre côté, on travaille toujours moins. Ces formulations paradoxales, et contradictoires, attestent dans leur ensemble que le temps social a déraillé. La vieille distinction entre «travail» et «non-travail» se résume à celle entre vie rétribuée et vie non rétribuée. La frontière entre l'une et l'autre est arbitraire, changeante, sujette à décision politique. La coopération productive à laquelle la force de travail participe est toujours plus vaste et plus riche que celle qui est en jeu dans le processus de travail. Elle comprend aussi le non-travail, les expériences et les connaissances qui ont mûri en dehors de l'usine et du bureau. La force de travail ne valorise le capital que parce qu'elle ne perd jamais ses qualités de non-travail (c'est-à-dire son inhérence à une coopération productive plus riche que celle que contient le processus de travail au sens strict). yuisque la coopération sociale précède et excède le processus de travail, le travail post-fordiste est aussi toujours du travail invisible. Cette expression ne désigne pas ici l'emploi non contractuel, «au noir». Le travail invisible est en premier lieu la vie non rétribuée, c'est-à-dire la part de l'activité humaine qui, complètement homogène par rapport à l'activité de travail, n'est pourtant pas prise en compte en tant que force productive. Le point décisif, c'est de reconnaître que, dans le travail, les expériences mûries en dehors de lui ont une importance prépondérante, en sachant bien toutefois que cette sphère plus large d'expérience, une fois incluse dans le processus de travail, est soumise aux règles du mode de production capitaliste. Là encore, le risque est double: ou nier l'ampleur de ce qui est inclus dans le mode de production, ou encore, au nom de cette ampleur, nier l'existence d'un mode de production spécifique.
Thèse 5 Dans le post-fordisme, il existe un écart permanent entre le «temps de travail» et un «temps de production» plus long. Marx fait la distinction entre «temps de travail» et «temps de production» dans les chapitres XII et XIII du deuxième livre du Capital. Que l'on pense au cycle semailles-récolte. Le journalier peine pendant un mois (temps de travail); puis il y a le long intermède de la maturation du grain (encore temps de production, mais pas temps de travail); enfin vient le moment de la récolte (de nouveau temps de travail). En agriculture et dans d'autres secteurs, la production est plus étendue que l'activité de production proprement dite; cette dernière constitue à peine une fraction du cycle complet. Le couple «temps de travail»/«temps de production» est un outil conceptuel extraordinairement pertinent pour comprendre la réalité post-fordiste, c'est-à-dire l'articulation actuelle de la journée de travail sociale. Au-delà des exemples bucoliques proposés par Marx, l'écart entre «production» et «travail» s'adapte assez bien à la situation décrite dans le «Fragment sur les machines», c'est-à-dire à une situation dans laquelle le temps de travail se présente comme un «résidu misérable». La disproportion prend deux formes différentes. En premier lieu, elle se donne à voir à l'intérieur de chaque journée de travail de chaque travailleur dépendant. L'ouvrier surveille et coordonne (temps de travail) le système automatique de machines (dont le fonctionnement définit le temps de production); l'activité de l'ouvrier se résume souvent à une sorte de manutention. On pourrait dire que, dans le contexte post-fordiste, le temps de production est interrompu, par moments seulement, par le temps de travail. Tandis que les semailles sont une condition nécessaire à la phase ultérieure de la croissance du grain, à l'heure actuelle l'activité de surveillance et de coordination est placée, du début à la fin, à côté du processus automatisé. Il y a ensuite une deuxième manière, plus radicale, de concevoir la disproportion. Dans le post-fordisme, le «temps de production» comprend le temps de non-travail, la coopération sociale qui s'enracine en lui (voir thèse 4). J'appelle donc «temps de production»»l'unité indissoluble de vie rétribuée et de vie non rétribuée, travail et non-travail, coopération sociale visible et coopération sociale invisible. Le «temps de travail» n'est qu'une composante et pas forcément la plus importante, du «temps de production» tel qu'on l'entend ici. Cette constatation pousse à reformuler, en partie ou en entier, la théorie de la plus-value. Selon Marx, la plus-value naît du surplus de travail, c'est-à-dire de la différence entre travail nécessaire (qui rembourse le capitaliste de la dépense qu'il a faite pour acquérir la force de travail) et l'ensemble de la journée de travail. Eh bien il faudrait dire que la plus-value, à l'époque post-fordiste, est déterminée surtout par le hiatus entre un temps de production non pris en compte comme temps de travail et le temps de travail proprement dit. Ne compte pas seulement l'écart, interne au temps de travail, entre travail nécessaire et surplus de travail, mais aussi (et peut-être davantage) l'écart entre temps de production (qui contient en lui-même le non travail, sa productivité particulière) et le temps de travail.
Thèse 6 Le post-fordisme se caractérise par la cohabitation des modèles de production les plus divers, et pour d'autres raisons, par une socialisation hors travail essentiellement homogène. Contrairement à l'organisation fordiste du travail, l'organisation post-fordiste est toujours et de toutes façons comparable aux taches du léopard. L'innovation technologique n'est pas universaliste: elle fait davantage que de déterminer un modèle de production univoque et porteur, elle maintient en vie une myriade de modèles différenciés, et elle en ressuscite même parfois certains qui sont dépassés ou anachroniques. Le post-fordisme réédite tout le passé de l'histoire du travail, d'îlots d'ouvriers-masse en enclaves d'ouvriers professionnels, d'un travail autonome regonflé à la restauration de formes de domination personnelle. Les modèles de production qui se sont succédés sur une longue période se représentent synchroniquement, à la manière d'une Exposition universelle. Le fond et le présupposé de cette prolifération de différences, de ce broyage des formes d'organisation, c'est pourtant le general intellect la technologie informatico-télématique, la coopération productive qui comprend en elle-même le temps de non-travail. Paradoxalement, c'est justement quand le savoir et le langage deviennent la principale force productive, que l'on assiste à la multiplication effrénée des modèles d'organisation du travail, ainsi qu'à leur cohabitation éclectique. Il faut se demander ce que le concepteur de logiciel informatique et l'ouvrier de chez Fiat ou le travailleur précaire ont en commun. Il faut avoir le courage de répondre: bien peu de choses sur le plan du salaire, des compétences professionnelles, et des caractéristiques du processus de travail. Mais aussi: tout, quant aux modes et aux contenus de la socialisation hors travail de chaque individu. Sont communes donc, les tonalités émotives, les goûts, la mentalité, les attentes. Mais tandis que cet ethos homogène (opportunisme, bavardage, etc.) est inclus dans la production et définit les profils professionnels dans les secteurs avancés, pour ceux qui sont affectés aux secteurs traditionnels ou pour les frontaliers qui oscillent entre travail et inoccupation, il innerve le «monde de la vie». Pour l'exprimer par une formule: le point de suture se trouve entre l'opportunisme mis au travail et l'opportunisme universellement sollicité par l'expérience urbaine. A la fragmentation des modèles de production, à leur cohabitation sur le mode de l'Exposition universelle, le caractère substantiellement unitaire de la socialisation décrochée du processus de travail fait contrepoint. Thèse 7 Dans le post-fordisme, le general intellect ne coïncide pas avec le capital fixe, mais se manifeste surtout comme interaction linguistique du travail vivant. Comme on l'a déjà dit, Marx a complètement identifié le general intellect (c'est-à-dire le savoir en tant que principale force productive) avec le capital fixe, avec la «capacité scientifique objectivée» du système des machines. Il a ainsi négligé l'autre aspect, aujourd'hui tout à fait dominant, selon lequel le general intellect se présente comme du travail vivant. Faire l'analyse de la production post-fordiste oblige à faire cette critique. Dans ce que l'on appelle le «travail autonome de deuxième génération», mais également dans les procédures de fonctionnement d'une usine radicalement modernisée comme celle de Fiat à Melfi, il n'est pas difficile de reconnaître que la connexion entre savoir et production ne s'épuise pas en fait dans le système des machines, mais qu'elle s'articule dans la coopération linguistique entre hommes et femmes, dans leur façon concrète d'agir ensemble. Dans le contexte post-fordiste, certains ensembles conceptuels et certains schémas logiques jouent un rôle décisif et ne peuvent jamais se figer dans le capital fixe, puisqu'ils sont indissociables de l'interaction d'une pluralité de sujets vivants. L'«intellect général» contient donc des connaissances formelles et informelles, de l'imagination, des penchants éthiques, des mentalités, des «jeux de langage». Dans les processus de travail contemporains, il y a des pensées et des discours qui fonctionnent par eux-mêmes, comme les machines de production, sans devoir emprunter un corps mécanique ni même une petite âme électronique. Le general intellect devient un attribut du travail vivant, alors que ce dernier consiste de plus en plus en prestations linguistiques. On peut ici toucher du doigt à quel point la position de Jürgen Habermas est infondée. Habermas, dans le sillage des leçons de Hegel à Iéna (cf. Habermas 1968), oppose le travail à l'interaction, l'«agir instrumental» (ou «stratégique») à l'«agir communicationnel». Selon lui, les deux contextes répondent à des critères qui sont sans commune mesure: le travail est réglé par la logique fins/moyens, l'interaction linguistique repose sur l'échange, sur la reconnaissance mutuelle, sur le partage d'un ethos identique. Aujourd'hui, cependant, le travail (dépendant, salarié, producteur de plus-value) est interaction. Le processus de travail n'est plus taciturne, il est loquace. L'«agir communicationnel» n'a plus son terrain privilégié, ou a fortiori exclusif, dans les relations éthico-culturelles et dans la politique, mais il déborde au contraire du contexte de la reproduction matérielle de la vie. Inversement, la parole dialogique s'installe au cœur même de la production capitaliste. Pour employer une formule:îafin de comprendre vraiment la praxis du travail post-fordiste, il faut de plus en plus se tourner vers Saussure et Wittgenstein. C'est vrai, ces auteurs se sont désintéressés des rapports sociaux de production: toutefois, puisqu'ils ont réfléchi à fond sur l'expérience linguistique, ils ont davantage à nous apprendre sur l'«usine loquace» que les économistes professionnels. On a déjà dit qu'une partie du temps de travail de l'individu est destinée à enrichir et à développer la coopération productive, c'est-à-dire la mosaïque dont elle constitue une pièce. En clair: le devoir du travailleur, c'est d'améliorer et de faire varier le lien entre son propre travail et les prestations des autres. C'est ce caractère réflexif de l'activité de travail qui fait qu'en elle les aspects linguistico-relationnels prennent une importance grandissante; qui fait aussi que l'opportunisme et le bavardage deviennent des outils de premier plan. Hegel avait parlé d'une «ruse du travail», en entendant ainsi la capacité de favoriser la causalité naturelle pour arriver à en utiliser la puissance en vue d'un objectif déterminé. Eh bien, dans le post-fordisme, la «ruse» hegelienne a été supplantée par le bavardage heideggerien.
Thèse 8 L'ensemble de la force de travail post-fordiste, même la plus déqualifiée, est force de travail intellectuelle, «intellectualité de masse». J'appelle «intellectualité de masse» l'ensemble du travail vivant post-fordiste (attention, il ne s'agit pas d'un quelconque secteur particulièrement qualifié du tertiaire) dans la mesure où celui-ci est le dépositaire de compétences cognitives et de communication non objectivables dans le système des machines. L'intellectualité de masse est la forme principale que revêt aujourd'hui le general intellect (cf. thèse 7). Inutile de dire que je ne fais nullement référence à une fantomatique érudition du travail dépendant; je ne pense évidemment pas que l'ouvrier d'aujourd'hui est un expert en biologie moléculaire ou en philologie classique. Comme je l'ai déjà dit, ce qui est surtout mis en évidence, c'est l'intellect en général, c'est-à-dire les attitudes les plus génériques de l'esprit: la faculté de langage, la disposition à l'apprentissage, la mémoire, la capacité d'abstraction et de faire des corrélations, la propension à l'autoréflexion. L'intellectualité de masse n'a rien à faire avec les œuvres de la pensée (livres, formules algébriques, etc.) mais plutôt avec la simple faculté de penser et de parler. La langue (comme l'intellect et la mémoire) est ce que l'on peut concevoir de plus courant et de moins «spécialisé». Ce n'est pas l'homme de science, mais le simple locuteur qui est un bon exemple d'intellectualité de masse. Cette dernière n'a rien à voir non plus avec une nouvelle «aristocratie ouvrière» et, en fait, elle en est même aux antipodes. A y regarder de plus près, l'intellectualité de masse ne fait que donner toute sa vérité, pour la première fois, à la définition de la force de travail de Marx que l'on a déjà évoquée: «la somme de toutes les attitudes physiques et intellectuelles qui existent dans la corporéité». Pour ce qui est de l'intellectualité de masse, il faut éviter ces simplifications assassines dans lesquelles versent ceux qui cherchent toujours la répétition confortable des expériences passées. On ne peut pas définir un mode d'être qui a son centre dans le savoir et dans le langage selon des catégories économico-productives. Il ne s'agit pas, en somme, d'un maillon de plus dans la chaîne constituée, que sais-je, de l'ouvrier de métier, puis de l'ouvrier de la chaîne de montage. Les aspects caractéristiques de l'intellectualité de masse, disons son identité, ne peuvent pas être repérés en relation avec le travail, mais en premier lieu sur le plan des formes de vie, de la consommation culturelle, des usages linguistiques. Toutefois, et c'est l'autre face de la médaille, quand la production n'est plus du tout le lieu spécifique de l'identité, à ce moment-là précisément elle se projette sur tous les aspects de l'expérience, subsumant en elle les compétences linguistiques, les penchants éthiques, les nuances de la subjectivité. L'intellectualité de masse est au cœur de cette dialectique. Il est difficile de la décrire en termes économico-productifs et en cela précisément (et pas malgré cela), elle est une composante fondamentale de l'accumulation capitaliste actuelle. L'intellectualité de masse (un autre nom pour la multitude) est au centre de l'économie post-fordiste précisément parce que son mode d'être échappe complètement aux concepts de l'économie politique.
Thèse 9 La multitude met hors jeu la «théorie de la prolétarisation». Dans le débat théorique marxiste, l'opposition entre travail «complexe» (c'est-à-dire intellectuel) et travail «simple» (sans qualité) a donné bien des soucis. Quelle est l'unité de mesure qui permet une telle opposition? Réponse dominante: l'unité de mesure coïncide avec le travail «simple», avec la simple dépense d'énergie psychophysique; le travail «complexe» est seulement un multiple du «simple». La proportion entre l'un et l'autre peut être déterminée en considérant les différents coûts de formation (école, spécialisations diverses, etc.) de la force de travail intellectuelle par rapport à la force de travail déqualifiée. Cette vieille question controversée m'importe peu ici; je voudrais cependant profiter, instrumentalement, de la terminologie que l'on a utilisée à son propos. Je pense que l'intellectualité de masse (cf. thèse 8), dans sa totalité, est du travail «complexe», mais, attention, du travail «complexe» irréductible à du travail «simple». La complexité, mais aussi l'irréductibilité, dérivent du fait que cette force de travail mobilise, dans l'accomplissement de ses fonctions, des compétences linguistico-cognitives humaines au sens générique. Ces compétences, ou facultés, font en sorte que les prestations de l'individu sont toujours marquées par un taux élevé de socialité et d'intelligence, tout en n'étant pas du tout celles de spécialistes (on ne parle pas ici d'ingénieurs ou de philologues, mais de travailleurs ordinaires). Ce qui ne se réduit pas au travail «simple», c'est, si on veut, la qualité coopérative des opérations concrètes que l'intellectualité de masse exécute. Dire que tout le travail post-fordiste est du travail complexe, non réductible à du travail simple, signifie aussi affirmer que la «théorie de la prolétarisation» s'avère aujourd'hui complètement hors jeu. Cette théorie mettait son point d'honneur à signaler l'équivalence tendancielle du travail intellectuel et du travail manuel. C'est précisément pour cette raison qu'elle se révèle inapte à rendre compte de l'intellectualité de masse ou, mais c'est la même chose, du travail vivant en tant que general intellect. La théorie de la prolétarisation échoue lorsque le travail intellectuel (ou complexe) n'est pas identifiable à un réseau de savoirs spécialisés, mais se confond avec l'utilisation des facultés linguistico-cognitives génériques de l'animal humain. Tel est le passage conceptuel (et pratique) qui modifie tous les termes de la question. La prolétarisation manquée ne signifie certes pas que les travailleurs qualifiés conservent des niches privilégiées. Cela signifie plutôt que toute la force de travail post-fordiste, complexe et intellectuelle, ne se caractérise pas par cette homogénéité par soustraction que le concept de «prolétariat» implique d'habitude. En d'autres termes: la prolétarisation manquée signifie que le travail post-fordiste est multitude, et non peuple.
Thèse 10 Le post-fordisme est le «communisme du capital». La métamorphose des systèmes sociaux en Occident, dans les années 30, a parfois été désignée par une expression à la fois claire et en apparence paradoxale: socialisme du capital. On fait allusion ainsi au rôle déterminant assumé par l'Etat dans le cycle économique, à la fin du laissez-faire libéraliste, aux processus de centralisation et de planification menés par l'industrie publique, aux politiques du plein emploi, aux débuts de l'Etat providence (du Welfare). La réplique capitaliste de la Révolution d'Octobre et de la Crise de 29 fut une gigantesque socialisation (ou, mieux, une étatisation) des rapports de production. Pour l'exprimer avec la phrase de Marx que je citais plus haut, il y eut « un dépassement de la propriété privée sur le terrain même de la propriété privée». C'est l'expression communisme du capital qui résume le mieux la métamorphose des systèmes sociaux en Occident dans les années 80 et 90. Cela veut dire que l'initiative capitaliste orchestre à son propre avantage les conditions matérielles et culturelles mêmes qui assurent le réalisme tranquille de la perspective communiste. Qu'on pense aux objectifs qui constituent le centre de cette perspective: abolition de ce scandale intolérable que constitue le travail salarié; disparition de l'Etat en tant qu'industrie de la coercition et «monopole de la décision politique»; valorisation de tout ce qui fait que la vie des individus est unique. Eh bien, au cours des vingt dernières années, on a mis en scène une interprétation captieuse et terrible de ces mêmes objectifs. D'abord: l'irréversible diminution du temps de travail socialement nécessaire est allée de pair avec l'augmentation des horaires de ceux qui sont «dans» le système et la marginalisation de ceux qui sont «en dehors». Même quand ils sont malmenés par les heures supplémentaires, l'ensemble des travailleurs dépendants se présente comme une «surpopulation» ou une «armée industrielle de réserve». En second lieu, la crise radicale, ou même la désagrégation des Etats nationaux s'explique comme une reproduction en miniature, à la façon des boîtes gigognes, de la forme-Etat. En troisième lieu, suite à la chute d'un «équivalent universel» capable d'être effectivement valide, on assiste à un culte fétichiste des différences, mais ces dernières, revendiquant un subreptice fondement substantiel, donnent lieu à toutes sortes de hiérarchies arbitraires et discriminantes. Si le fordisme avait englobé, et retranscrit à sa façon, certains aspects de l'expérience socialiste, le post-fordisme a ôté tout fondement au keynesianisme comme au socialisme. Le post-fordisme, enchâssé comme il l'est dans le general intellect et la multitude, décline à sa façon les instances caractéristiques du communisme (abolition du travail, dissolution de l'Etat, etc.). Le post-fordisme est le communisme du capital. Derrière le fordisme, il y a eu la révolution socialiste en Russie (et, même si elle a été vaincue, une tentative de révolution en Europe occidentale). On peut se demander quel tumulte social a servi de prélude au post-fordisme. Je crois que dans les années soixante et soixante-dix, il y a eu en Occident une révolution vaincue. La première révolution qui ne se soit pas élevée contre la pauvreté et l'arriération, mais spécifiquement contre le mode de production capitaliste, donc contre le travail salarié. Si je parle d'une révolution vaincue, ce n'est pas parce que beaucoup jacassaient à propos de la révolution. Je ne me réfère pas au carnaval des subjectivités, mais à un état de fait plus sobre: pendant une longue période, dans les usines comme dans les quartiers populaires, dans les écoles comme dans certaines délicates institutions d'Etat, deux pouvoirs opposés se sont confrontés, entraînant une paralysie réelle de la décision politique. De ce point de vue – objectif, sobre – on pourrait soutenir qu'en Italie et dans d'autres pays occidentaux, il y a eu une révolution vaincue. Le post-fordisme, ou le «communisme du capital», est la riposte à cette révolution vaincue, si différente de celle des années vingt. La qualité de la riposte est égale et contraire à la qualité de la demande. Je crois que les luttes sociales des années soixante et soixante-dix ont exprimé des revendications non socialistes et même antisocialistes: la critique radicale du travail; le goût marqué pour les différences ou, si l'on préfère, le raffinement du «principe d'individuation»; non plus l'aspiration à se soumettre à l'Etat, mais une attitude (parfois assez violente, certes) menant à se défendre de l'Etat, à rompre le lien à l'Etat en tant que tel. Il n'est pas difficile de reconnaître des idées et des orientations communistes dans la révolution manquée des années soixante et soixante-dix. C'est pour cette raison que le post-fordisme, qui représente une riposte à une telle révolution, a donné vie à une sorte de «communisme du capital» paradoxal.
|
Dix thèses sur le post-fordisme
|
|||
| <<< >>> |