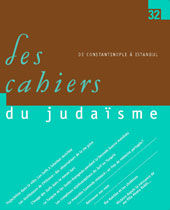|
On a beaucoup écrit sur les Juifs réfugiés dans l’Empire ottoman après l’expulsion d’Espagne en 1492. Mais que sont-ils devenus, de l’Empire turc à nos jours en passant par le moment crucial de la Révolution d’Atatürk, quelle a pu être leur place, en tant que minorité, dans cette nation républicaine? Entre cosmopolitisme et nationalisme, de quelle manière les Juifs ont-ils maintenu des liens de sociabilité, des pratiques propres tout en affirmant leur appartenance à cette société multiple? Comment ont évolué leurs relations avec les autorités du pays, dans un contexte politique compliqué dans lequel s’invitent en outre les passions liées au conflit du Moyen-Orient? Quels enjeux mémoriels se font jour, entre déclarations optimistes et inquiétudes sous-jacentes? Autant de questions qui se posent avec une particulière acuité en ce qui concerne les Juifs d’Istanbul qui, avec environ 17000 membres1, constituent aujourd’hui la communauté la plus importante en terre d’islam.
Liée à l’explosion démographique et à l’expansion géographique de la ville, la dissémination spatiale des Juifs est emblématique des bouleversements vécus au cours du XXe siècle. Riva Kastoryano retrace les trajectoires successives suivies par de nombreuses familles qui ont quitté les quartiers traditionnels de peuplement juif – Balat ou Hasköy notamment, qui font l’objet de longues descriptions de la part des instituteurs de l’Alliance israélite universelle en poste dans ces écoles – pour aller habiter dans des quartiers moins ‘marqués’ avant de s’installer, quand elles le peuvent, dans des «cités-résidences» construites à partir de la fin des années 1970 sur les collines face au Bosphore côté européen. Ces ensembles immobiliers haut de gamme représentent de nouveaux points de repère pour affirmer un statut social dans la communauté – et dans la société –, en effaçant des mémoires les références historiques dans la ville qui permettaient de situer l’individu et/ou la famille dans la hiérarchie interne.
Le romancier Mario Levi dépeint ce milieu comme un «conte», monde foisonnant «où chacun vivait à sa façon son propre statut d’étranger malgré des histoires communes qui rattachaient chacun à sa ville d’une manière indéracinable». Comme le montre Marc Semo, son ouvrage empreint de nostalgie se présente comme «un témoignage de ce monde évanoui, victime du nationalisme turc». Les Juifs ne renoncent pas pour autant à œuvrer au maintien de leur langue, le judéo-espagnol, de leur culture et de leurs traditions ainsi qu’en témoigne le Centre de recherche sur la culture séfarade ottomane et turque créé en 2003 et dont Karen Gerson Sarhon détaille les activités. Les réformes entreprises par le gouvernement au pouvoir AKP dans le sens de la liberté religieuse, qui se traduit par la libération de la loi sur les Vakif, a permis la réfection d’anciennes synagogues. Ici comme ailleurs, les enjeux mémoriels sont significatifs et Nora Seni pose explicitement la question: la restauration du mausolée des Camondo va-t-il engendrer une mémoire partagée, ou bien des mémoires fragmentées et éventuellement conflictuelles?
Car une ambiguïté persiste qui caractérise les relations des Juifs turcs avec leurs concitoyens non juifs et avec les autorités, quelle que puisse être la prégnance de l’image souvent véhiculée d’une très ancienne et inaltérable «amitié turco-juive». Les trente-trois ouvrages littéraires publiés entre 1921 et 1994 et passés au crible par Rifat Bali montrent une image des Juifs entachée des stéréotypes les plus éculés: la passion de l’argent, la non-intégration dans le pays d’accueil et l’absence de tout sentiment patriotique, l’immoralité. On ne peut oublier pourtant, comme le montre Alain de Tolédo à partir de son analyse de l’ouvrage de l’ambassadeur Bilâl Simsir, que des diplomates turcs en poste dans les pays de l’Europe occupée s’efforcèrent de protéger une partie, même limitée, de leurs ressortissants juifs de la déportation, des trains ramenant ainsi de France en Turquie plus de quatre cents personnes installées souvent à Paris. Reste que les Juifs font toujours face à un antisémitisme récurrent: Laurent-Olivier Mallet analyse ainsi la recrudescence contemporaine des manifestations d’antisémitisme, parfois jusqu’à la violence physique et au terrorisme – comme l’ont montré en particulier les attentats de 2003 – et l’instrumentalisation du conflit israélo-palestinien. Qu’on songe à l’affaire de la flottille de Gaza et au drame du Mavi Marmara en mai 2010, dont le souvenir s’est trouvé revivifié par la nouvelle tentative de forcer le blocus en cet été 2011. Les Juifs, comme le souligne Mallet, demeurent cependant comme «une butte-témoin d’un passé source de nostalgie», à travers leurs représentations, c’est la société turque qui se perçoit elle-même.
|