|
Gershom Scholem:Le prix d'Israël |
||
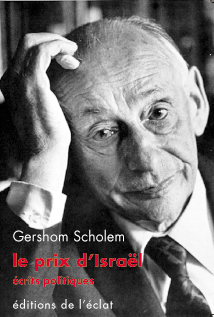 |
10. Mémoire et utopie dans l’histoire juive (1946) |
|
Cette conférence a été prononcée à Jérusalem le 6 mars 1946, lors d’une rencontre avec des dirigeants des mouvements de jeunesse et des enseignants. L’original en hébreu, retranscrit et édité par Avraham Shapira, figure dans Od Davar, p. 187-198. Une traduction anglaise a été publiée dans le volume On the Possibility of Jewish Mysticism in our Time, Philadelphia-Jerusalem, 1997. Ce texte ne figure pas dans la Bibliographie. Scholem est revenu sur la question de l’enseignement lors d’une rencontre avec des enseignants israéliens en 1963 [Bibliographie, 382, 383]. L’entretien a été repris dans Od Davar, p. 105-119; une traduction française a paru dans Dispersion et unité, n° 11, 1971, p. 149-159, sous le titre «Une éducation au judaïsme. Un entretien du Pr. G. Scholem».
|
||||
|
La question de la continuité des générations est liée à celle de la tradition du passé: à savoir la transmission du passé et la relation à cette transmission. C’est le problème du présent du passé; comment trouver le passé dans le présent? Cette question en implique deux autres: a) Dans quel sens existe-t-il une continuité des générations? b)Sommes-nous liés par cette continuité? Les forces vives à l’œuvre dans le mouvement sioniste ont répondu positivement à la première question et négativement à la seconde. La conception, à la fois très compréhensible et très dangereuse, qui voyait dans le sionisme une révolution destinée à renouveler la physionomie de la nation, adhérait naturellement, et en toute légitimité et nécessité, à l’avis selon lequel la contradiction, la critique, la rupture avec le passé étaient nécessaires si l’on voulait sauver quelque chose. Ce révolutionarisme était commode pour nous tous, aussi longtemps qu’il y avait quelque chose contre quoi nous pouvions nous révolter. Aujourd’hui, après le terrible malheur qui s’est abattu sur notre peuple, notre situation s’est tragiquement modifiée: la révolution se trouve dans un espace vide d’un point de vue national, la nation n’est plus ce grand réservoir soucieux de préserver une continuité de ce contre quoi nous pouvons nous révolter. Nous devons nous soucier, par nous-mêmes, des deux aspects à la fois. La prise de conscience d’une continuité historique n’est pas sans poser de problèmes; la question se représente à chaque moment historique. À chaque moment, l’histoire est remise en question par des impulsions verticales et horizontales. Nous voyons non seulement le résultat de la causalité historique des doctrines antérieures, mais aussi de la causalité du présent, et tout cela agit sur nous, sur tout ce que nous faisons, pensons ou désirons. Tout cela a une influence, même si nous ne sommes pas en mesure de dire laquelle, ni jusqu’à quand elle durera. C’est un phénomène qui peut perturber le sens de la continuité historique. Même si l’impact du présent sur nous est en contact permanent avec la conscience historique, d’énormes contradictions internes reposent sur cette dernière. Par sa nature même, la réalité est dialectique et pleine de contradictions, c’est pourquoi il n’est pas étonnant de retrouver ces mêmes contradictions dans la nature de notre conscience historique. La continuité des générations, comme je viens de le dire, est liée à la conscience du passé, à la mémoire historique. C’est là que commence, pour moi, la problématique la plus difficile; nous voulons donner une image du passé sur la base de ses symboles demeurés dans le présent. Les monuments qui se présentent à nous sont soit perçus comme étant dignes d’être remémorés, soit introduits involontairement dans notre mémoire par des processus plus puissants que celui de notre volonté. Le choix constitutif de notre image du passé se fait selon l’intuition, selon les possibilités, selon notre capacité de conscience et selon nos intérêts. Il s’élabore sur la base d’un mélange de souvenirs et d’espoirs, dont les combinaisons déterminent l’histoire d’une manière impossible à définir et à analyser ou à décrire complètement. Nous avons l’habitude de nous moquer des premiers auteurs de chroniques – les pères de la science historique –, qui ne faisaient pas de distinction entre les grands et les petits événements dans le processus historique. Ils notaient tout et n’avaient ni lignes directrices, ni buts. Ils ignoraient le grand jeu du dialecticien moderne. Celui-ci essaie d’analyser les choses dans lesquelles il perçoit un certain rapport à des tendances cachées dans le passé, qu’il s’efforce de porter à la lumière du présent ou du futur. Notre ironie à l’égard de cet ancien chroniqueur n’est ni fondée ni légitime, car il était en fait le seul à avoir une réelle intuition historique. Il s’interdisait, par principe, que quelque chose fût perdue pour l’avenir. En vérité, ces petits détails qu’il a notés et auxquels personne n’a prêté attention pendant des milliers d’années, deviendront un jour des principes fondateurs. L’histoire de l’économie mondiale ou de la société en apporte de nombreuses preuves. Personne n’a relevé l’importance des différences de prix depuis l’époque d’Hérodote, ni celle d’autres informations marginales pour la compréhension d’une époque historique ou des grands événements. C’est pourtant, en fin de compte, sur la base de ces détails que les historiens sont capables de reconstituer la véritable image des événements. Aujourd’hui, c’est, dans une large mesure, dans les petits détails que nous trouvons une clé pour notre compréhension, bien plus que dans les grands événements – descriptions de guerres et tout ce qui s’y rapporte – qui faisaient l’objet, il y a un certain temps, d’un commentaire historique. La question est de savoir s’il est possible d’écrire l’histoire du point de vue du simple individu, selon la perspective des vaincus et non plus selon celle des vainqueurs, qui est celle qui, jusqu’à présent, a prédominé. La continuité des générations est un problème dialectique. Les images des générations peuvent changer, il est même nécessaire qu’elles changent avec chaque développement de notre propre conscience, avec chaque possibilité de découvrir de nouveaux symboles (du passé) qui ont été oubliés ou négligés. Ces symboles ne sont pas seulement façonnés par d’autres symboles du passé imprimés dans notre conscience, ou par ceux que l’on peut y découvrir, mais aussi par des espoirs et des utopies à venir. Ils nous influencent tout autant que l’intérêt pour le prKsent ou les estimations qui résultent de la sympathie ou de l’antipathie. Le passé ne devient pas vivant sans quelque élément utopique, sans l’espoir que ce qui se tient derrière tous nos efforts historiques vienne sauver quelque chose de lui. C’est comme si nous pouvions comprendre les échecs des tendances du passé, à la lumière d’une nouvelle tendance qui doit triompher dans le futur. Nous nous intéressons à l’histoire parce qu’elle contient les petites expériences de la race humaine, de même qu’elle contient la lumière dynamique de l’avenir. Dans les échecs de l’histoire subsiste encore une force qui peut vouloir sa correction (tikkun). C’est à partir de tous ces éléments que nous faisons notre choix. Et nous savons que ce choix ne contient qu’une part minime de la véritable expérience humaine et dont de très larges portions, opaques et invisibles, restent énigmatiques. L’historien se voit comme préposé à la préservation du passé dans la mémoire, mais, d’un autre côté, le passé devient pour lui un outil dans la bataille de l’avenir. La mémoire est le matériau essentiel où il va puiser. Mais la mémoire est aussi liée à l’oubli, qui n’est pas moins important que le souvenir. Quand je pense à l’histoire du judaïsme et des Juifs, il me semble que l’oubli est plus important que la mémoire comme élément premier, même si les textes fondamentaux du judaïsme nous obligent à considérer la mémoire comme principe fondalemental. Se souvenir, se souvenir, encore se souvenir ! Et, malgré cela, la mémoire juive de l’image du passé juif est extrêmement faible. Je suis convaincu que l’histoire juive a payé le prix fort pour l’utopie messianique. La nation juive a payé avec beaucoup d’énergies productives le prix de son utopie, qui l’a toujours mise du côté des vaincus appelés à vaincre dans le futur. La force immense de l’utopie me donne espoir que nous n’aurons plus longtemps à avoir honte de notre histoire. Mais, en même temps, cette utopie – cette concentration sur l’action à venir – est ce qui a oblitéré les éléments concrets de notre mémoire. On dit habituellement des Juifs qu’ils ont une bonne mémoire. Ce n’est pas la vérité. Nous oublions davantage que tout autre nation cultivée, et notre oubli est double: il contient autant d’éléments de l’avenir que d’éléments du passé, qui n’ont pas gardé de vitalité et ont sombré dans l’abîme de l’oubli. L’oubli n’est pas seulement absence. C’est une force aussi réelle que la remémoration. Il y a dans l’oubli la même force infinie des symboles appelés à se révéler dans le monde de demain. Nous nous souvenons de choses liées aux grandes cristallisations du passé. Mais ces cristallisations sont extrêmement dialectiques, elles ne sont pas seulement idéales. Les grandes valeurs dans lesquelles se concrétisent les processus historiques sont le résultat de victoires et non de défaites. Toute valeur concrétisée qui revient dans notre mémoire historique est aussi (dans une certaine mesure) déjà douteuse, du fait même qu’elle est remémorée et tramée dans l’histoire, puisqu’elle est la parole des vainqueurs de la génération. Nous nous souvenons de ce dont nous voulons nous souvenir et non pas de ce dont nous devrions nous souvenir. Je voudrais également insister sur deux autres choses: pour la personne qui regarde le passé depuis le présent, il y a un index du passé qui contient deux signes contradictoires: a) Le passé est incomplet; quelque chose manque en lui. Il est refermé sur lui-même. Il contient toujours des tendances qui n’ont pas trouvé leur correction (tikkun); il y a toujours des choses que nous aurions aimé savoir – peut-être sont-elles le sujet de nos rêves – et qui n’ont pu parvenir à leur pleine cristallisation. Ce défaut constitutif du passé saute aux yeux, et la volonté de l’homme de le corriger, à la lumière de l’image qu’il lui associe, est un désir élémentaire. b) Le passé a les caractéristiques d’un symbole et, en tant que tel, il est en contradiction avec son aspect vulnérable et incomplet. Les discussions sur le passé sont mensonge. Le passé n’est jamais entièrement passé. Il est encore avec nous, il dispose toujours d’un portillon qui ouvre sur le présent, l’avenir ou encore sur la rédemption. En même temps, il me semble que le passé a le caractère d’un symbole. Il se peut que ce ne soit pas nécessairement un symbole exhaustif de la chose. Il peut exister des symboles du manque de complétude. Il n’en reste pas moins vrai que, dans notre conscience du passé, l’histoire constitue un symbole d’échec permanent. D’un côté, l’histoire juive nous apparaît comme un échec dont le défaut doit être corrigé. D’un autre côté, le passé historique apparaît dans une rétrospective arbitraire. Il y a contemplation du symbole de la réalité qui constituait un tout, et en tant que symbole de la réalité, elle possède une force. Le symbolisme de l’histoire est en fait sa force décisive inhérente. L’image que nous constituons à partir des différents symboles pour en faire un seul grand symbole, éclaire notre voie vers un point d’où nous tirons notre rapport aux événements et aux situations du passé. Comme on peut le déduire de mes propos, notre rapport à l’histoire juive ne peut pas être simple. Notre image du passé change tellement, que nous devons nous demander si nous pouvons en apprendre quelque chose, ou même en tirer quelque enseignement. L‘histoire juive peut être envisagée de manière complètement différente de celle dont nos ancêtres pouvaient la concevoir. Ses images et ses représentations ont certainement changé de très nombreuses fois et sont toujours en transition. Nous voulons aujourd’hui une image du passé pour transmettre quelque chose à la prochaine génération. Nous en ressentons le besoin. L’intérêt vital que nous découvrons tous dans l’actualisation de l’histoire juive comporte un grand risque, le danger d’un subjectivisme tendancieux. J’ai dit que je ne crois pas au rapport contemplatif à l’histoire, je n’ai pas dit que cela implique que l’homme, doué d’une conscience historique, soit autorisé à s’occuper d’historiographie ou d’histoire d’une manière tendancieuse. Le grand danger réside dans la tendance à vouloir faire des choix. Et la seule garantie est la volonté de la vérité. L’homme est contraint de rechercher la vérité, tout en sachant qu’elle est loin de lui (et même s’il utilise pleinement tout ce qu’il a à sa disposition, il ne peut écrire qu’à partir des données de son époque et de ses souvenirs, etc.). Mais s’il commence à rassembler toutes les combinaisons qui lui viennent à l’esprit – et c’est un danger très présent en Eretz-Israël et dans le peuple juif en ce moment précis de l’histoire – nous sommes perdus d’avance. Pour nous, comme je l’ai déjà dit, la question de la conscience de la continuité des générations est une question religieuse. La mémoire juive de l’histoire juive est une mémoire religieuse. On ne peut pas y échapper. C’est un fait élémentaire de la tradition, et nous nous demandons: est-ce que la conscience historique du passé peut changer ce fait fondamental? Est-ce que tout ce que l’histoire juive contient dans ses principales valeurs, tout ce qu’elle enseigne, peut être dépouillé de sa forme et de son contenu religieux? La réponse est claire: nous nous trouvons dans une situation plus radicale que celle d’autres peuples, où même les plus révolutionnaires d’entre eux n’ont pas rejeté leur passé autant que nous avons pu le faire. L’Anglais ne rejette pas la tradition chrétienne de son histoire, même s’il n’accepte pas la responsabilité de ses actes barbares et de toutes ses corruptions et de ses échecs. Même s’il n’accepte pas le dogme chrétien, il ne lui tourne pas pour autant le dos. Il en va de même pour tous les autres peuples. À cet égard, nous nous trouvons dans une impasse et il nous est impossible de ne pas le dire explicitement. Aussi la question de notre continuité par rapport aux générations de nos ancêtres est une question très difficile, parce qu’elle impose une décision: est-ce que nous sommes disposés à rejeter toute forme culturelle pour peu qu’elle ait une dimension religieuse, dont nous ne sommes peut-être pas prêts à accepter les conséquences, ou est-il possible de renverser les choses et de dire que cette grande souffrance des générations nous lie dans une même mesure? C’est une question fondamentale, particulièrement dans nos vies séculières. Pour le Juif religieux, la réponse est simple. Mais le Juif religieux ne détermine pas pour le moment le visage de la génération actuelle. D’où la question: pouvons-nous continuer même si nous refusons nombre des valeurs religieuses du passé de nos ancêtres? Nous devons nous demander si nous sommes capables d’appliquer des méthodes critiques à notre mémoire et à nos souvenirs, également pour ce qui concerne leur lien avec les questions religieuses. Ici la sécularisation de l’éducation ne peut pas être d’une grande utilité: elle comporte une grande part de mensonge et d’auto-déception. Nous partons de l’hypothèse que les textes enseignés à l’école sont des documents nationaux que nous ne considérons pas comme contraignants. C’est peut-être ce qui nous différencie des autres peuples. Les textes sur lesquels nous fondons notre éducation sont des documents religieux et en en faisant des documents laïcs, il est clair que nous les modifions de manière fondamentale. Nous découvrons et mettons en relief des aspects que leurs auteurs ne considéraient pas comme importants. Nous enseignons la Bible comme un livre d’étude avec une légère tendance à la «Berdichevsky»: pour montrer le côté positif et vivant de cette nation. Et nous enseignons la Aggadah avec la volonté de montrer la grandeur de la force créatrice de l’imagination populaire. Nous créons une nouvelle image à partir des symboles du passé, et cette image est tendancieuse parce qu’en toute connaissance de cause, nous retirons à ces documents les valeurs qui ont permis qu’ils soient préservés et qui les ont rendus dignes d’être remémorés. C’est un phénomène qui me trouble. Mais la question est de savoir si nous pouvons légitimement faire cela, si nous sommes autorisés à faire ce choix pour nous-mêmes, et si, de cette manière, une tradition juive est possible sans Dieu? Nous voyons constamment que c’est possible, mais la question est: où cela nous mène-t-il? Est-ce que cela nous mène à un enrichissement du contenu vital des documents et à la résolution de leur problématique vitale, ou nous est-il imposé d’y renoncer si nous ne pouvons pas nous intéresser aux documents du passé en les respectant? Voilà la question que je voudrais vous poser. La tendance de l’enseignant, ici en Eretz-Israël, est de minimiser la gravité du problème religieux. Mais ce que nous effaçons aujourd’hui rejaillira avec d’autant plus de force demain et d’une autre manière. On ne peut pas savoir où apparaît le problème religieux qui est enfoui dans notre mémoire historique, ni où il émergera demain ou après demain. Il est impossible de le prédire. Il est très difficile de discuter de la possibilité d’une continuité historique en Israël si nous esquivons ce problème. Je ne suis pas un Juif orthodoxe et je ne peux, ni ne veux enseigner aux gens de croire comme nos ancêtres ont cru. Néanmoins, je m’interroge sur l’intérêt qu’il y a à étudier ces textes s’ils n’ont pas de sens pour moi, si je ne dois pas leur apporter de réponse, si je n’essaie pas au moins de les regarder face à face, sans détour, selon leur propre lumière, celle-là même que j’ai pu découvrir en eux. À ce point, il me semble qu’il ne nous reste plus qu’à essayer d’affronter le problème très complexe des matières religieuses dans l’éducation. La question que nous devons éclaircir est la suivante: dans quelle mesure peut-on espérer une continuité de notre histoire si nos enfants ne sont pas confrontés à la question du passé? Il se peut que chacun de nous fasse selon ce que la nouvelle expérience lui dicte de faire. N’étant pas prophète, j’ignore quelle forme prendra la foi dans la prochaine génération. Mais je crois en la nécessité historique de poser la question à la prochaine génération. Je pense qu’enseigner la Bible et ne pas clarifier les questions fondamentales qui y sont liées n’est pas une approche fructueuse. Elle est même stérile. En faisant cela, nous encourageons les gens au déni et à la fuite. Nous ne pourrons pas faire face à des phénomènes aussi paradoxaux pour nos contemporains. L’une des choses les plus difficiles et qui galvaude l’enseignement de la Bible, est la manière de poser la question de l’attitude de l’homme devant Dieu, sans clarifier le sujet de la petitesse de l’homme dans sa propre existence. En d’autres termes: peut-on véritablement interpréter la Bible, le Talmud, les livres de prière, le piyyut, les traités de morale – c’est-à-dire tout l’immense trésor que nous possédons – sans considérer leur contenu? Est-ce qu’une approche si révolutionnaire est possible et peut-elle apporter la moindre bénédiction à notre existence ici? Pour ce qui me concerne, j’en doute fort, bien entendu. Quand j’enseigne ma discipline aux séminaires de l’Aliyah des jeunes, je me demande souvent ce qu’en pensent ces bons enfants, qui seront les enseignants de demain. Est-ce que cela les intéresse ou pas ? Si c’est le cas, pourquoi ? Est-ce intéressant, parce qu’il est question des choses absurdes, d’échecs retentissants et des rêves éteints? Et, dans ce cas, l’intérêt n’est-il pas simplement littéraire ou esthétique? J’ai souligné à plusieurs reprises que dans notre relation à nombre de problèmes qui concernent notre passé, nous nous mentons à nous-mêmes: les réponses sont vraiment très actuelles et les gens y voient une sorte d’actualité dissimulée, même s’ils essaient de ne pas les voir sous le déguisement du problème religieux dont elles sont issues. J’ai du mal à me résoudre à croire qu’il est possible d’abstraire les choses de cette forme sans oublier le passé. Sans la problématique religieuse, notre passé serait oublié, devrait être oublié et même ne mériterait pas d’être remémoré, car l’héroïsme des Juifs est une affaire des plus douteuses d’un point de vue historique. Dès lors que la question de la religion ne sera pas posée à l’historien juif, en même temps que les clarifications de ces questions par les dernières générations, notre histoire deviendra stérile. Une éducation socialiste aurait pu donner à la génération à venir une énorme potentialité humaine: une histoire qui n’aurait pas été écrite par les vainqueurs. L’histoire des autres nations du monde a été écrite par les dirigeants vainqueurs, tandis que les nôtres n’étaient pas de grands dirigeants et, pour autant que nous en avons eu, ils n’avaient aucune importance. Si notre histoire présente un intérêt, cet intérêt réside dans son adéquation secrète avec les idées de l’avenir, avec le choix décisif du peuple de payer le prix pour la direction messianique de son histoire, cette même direction messianique qui est coupable des échecs de l’histoire juive. Pourquoi toute notre histoire est-elle «antipathique»? Si ces Juifs n’avaient pas des illusions religieuses, ils auraient pu corriger leur situation sept fois par leurs propres moyens, sans la lier à l’idée de la rédemption (pour laquelle ils ont payé le prix fort). Ici, le socialiste juif a intérêt à répondre à un enjeu de taille: existe-t-il une possibilité unique de transformer l’histoire d’un peuple, faite entièrement d’échecs, de possibilités, du problème de l’avenir, en celle d’un peuple qui réalise sa propre vie au présent? Ou y a-t-il un espoir de changement dans une interprétation allégorique de ces symboles, pour qu’ils correspondent à une nouvelle interprétation séculière? La question est de savoir si nous considérons la chose possible, et si nous aurons besoin d’enseigner et d’expliquer à la génération suivante la destruction de nos frères et de nos sœurs en Europe, sans nous demander pourquoi une grande partie de la nation s’est laissée assassiner? Pourquoi ont-ils «sanctifié le Nom», comme on dit? Je doute que nous voulions vraiment nous lier, comme on le proclame par monts et par vaux, à la mémoire des millions de Juifs qui ont été tués en Pologne, en Lituanie, etc. Je doute que cela soit possible sans affronter la grande problématique de notre vie. Nous devons voir la réalité qui nous contraint à interpréter cette catastrophe sans précédent. Nous ne savons pas quelles réponses nous pouvons apporter, mais nous ne pouvons échapper à la question. Même la tentative la plus radicale de nier la réalité du problème de la transcendance dans nos vies, même la volonté la plus radicale, se heurte ici à la fois à la tentative d’expliquer, d’une manière terriblement concrète, le destin de leurs pères aux enfants, et à la question de la religion. Je ne sais pas comment vous parvenez à résoudre cette question dans votre travail. Il y a bien sûr une routine connue pour ce genre de chose, qui consiste à éviter la question ou à questionner ou ne pas questionner. Au point où nous en sommes, je veux dire ceci: tout d’abord n’esquivez pas la question, mais posez-la. Je pense que c’est la seule possibilité de créer un lien historique entre nous et les générations précédentes – de débattre sérieusement des questions soulevées ici. Je suis certain que cela ne nous rendra pas orthodoxes. Notre volonté d’éducation est en vue d’une relation positive au passé d’une nation, en tenant compte aussi de tous ses échecs, pour son avenir. Et comme nous l’avons dit, cela n’est pas possible si nous n’essayons pas à nouveau de poser la douloureuse question du caractère particulier de cette nation. Maintenant si, sur cette base, vous me demandez s’il y a une essence déterminée du judaïsme qui peut être enseignée ou avec laquelle il est nécessaire de rester en relation, ma réponse est non. En tant qu’historien, je ne crois pas qu’il y ait un seul judaïsme. J’ai été incapable de le trouver pendant toutes les années au cours desquelles je me suis occupé de ce problème. Le judaïsme de chaque époque ressemble davantage à son propre monde qu’il ne ressemble au judaïsme ultérieur. Je suis sûr que le judaïsme de Maïmonide était plus proche du christianisme ou de l’islam de ses contemporains qu’il ne l’est du judaïsme du Juif d’aujourd’hui. Voilà ce que je crois. Je suis convaincu que notre foi aujourd’hui, si nous en avons une, est plus proche de la croyance de celle des autres nations du monde que de celle de nos générations précédentes. Je ne crois pas en une essence unique du judaïsme. Je suis certain qu’il y a quelque chose d’unique qui force les Juifs à se poser des questions et à chercher des réponses et je suis certain que cette même substance, quelle que soit sa forme, se concrétisera de nouveau dans un changement d’apparence. Mais cette substance du judaïsme n’est pas sujette à définition; elle fait partie de ces totalités, qui ne peuvent être formulées, et n’en sont pas néanmoins présentes dans notre réalité. Nous avons en commun un passé qui n’est pas sujet à définition. Cette substance, qui est continue dans la perception historique du peuple juif, ne peut être correctement comprise si nous n’essayons pas de voir en face l’intention particulière, la souffrance particulière, propres aux questions que nous avons soulevées. Je recommande de ne pas éviter ces questions, pas seulement ici dans notre débat, mais particulièrement dans notre relation avec ceux auxquels devra s’adresser notre enseignement. |
|
|||
|
Brefs propos (aux questions qui ont suivi la conférence)
Ma conférence ne suppose aucune négation de la continuité historique. On peut comparer cette continuité à une ligne continue sans indication de direction: on peut aussi prendre comme exemple la ligne tangente en géométrie, parce qu’elle possède également une continuité de tous les points, sans avoir de continuation en aucun endroit. L’attitude simpliste à l’égard du problème de la religion à laquelle nous avons été habitués au cours des générations, n’est pas satisfaisante. L’interprétation séculière des concepts religieux est problématique. De la même manière que nous ne sommes pas autorisés à faire une distinction absolue entre sécularisme et religion, nous ne pouvons pas ternir la nature particulière des problèmes religieux au moyen de prétextes philosophiques. Il faut être précis dans l’utilisation des notions de «sécularisme» et de «religiosité». Il est clair qu’il existe un sécularisme qui n’est pas du tout lié à la religion, mais on doit remarquer en même temps le fait que des manifestations séculières peuvent apparaître parfois sous une apparence religieuse. Même une analyse historique minutieuse ne peut résoudre l’énigme cachée dans l’essence inexpliquée de la religion. L’explication positiviste prétend réfuter la religion à partir d’une interprétation rationaliste de l’absolu. Le positivisme est une théologie inversée. Son principe de base, selon lequel tout peut être expliqué de manière à ne laisser aucune question sans réponse, s’attribue lui-même un statut de principe absolu. Ce même principe vaut également pour la pensée de Marx. Le fait de nous expliquer comment l’homme place au-dessus de lui une autorité absolue, devant laquelle il se prosterne et s’agenouille ne constitue nullement une explication ou une critique de la religion. Il se peut que cette explication soit de quelque utilité pour comprendre la sociologie de certains problèmes religieux, mais elle ne touche pas au problème central de la religion. Aucun des exégètes de la religion du siècle dernier, Feuerbach, Marx, Kierkegaard et Nietzsche, n’ont réussi à expliquer le concept de base de la Torah, «l’image de Dieu» (tselem Elohim), une idée simple et bouleversante de profondeur. Cet évitement du problème religieux caché à l’intérieur de la Bible, se reflète aussi dans les différentes approches de son enseignement en Eretz-Israël. On ne peut pas dire qu’on aide utilement à faire revivre ce livre en essayant de l’expliquer comme un epos national ou un document semblable à tous les autres, tirés du folklore de l’antique Proche-Orient. De cette manière, ce texte central de la religion juive est transformé en un document tout à fait trivial, vidé de la vie qui l’anime. Ceux qui ignorent le problème lui-même n’ajoutent rien à la valeur de la Bible, mais ils l’amoindrissent. Ils finissent par dissiper son contenu au lieu de le transmettre aux générations à venir. L’explication séculière a l’épaisseur d’un fil, et nous devons examiner attentivement le concept de sécularisme avant de le choisir comme la seule explication possible. Le sécularisme n’est rien d’autre qu’un passage étroit d’un dogme religieux à un autre. Le sécularisme est valable aussi longtemps qu’il n’exige pas de sacrifices sur son autel; il disparaît dès l’instant où l’on demande à des gens de mourir pour quelque chose. Le concept d’«humanisme» est étroitement lié à celui de sécularisme. Nous sommes habitués à magnifier l’humanisme comme le contraire de la religion, comme un parfait substitut de la foi religieuse. Mais il n’est jamais arrivé dans l’histoire, pas plus qu’il n’arrive aujourd’hui, que des gens se fassent tuer au nom du sécularisme. Les hommes ne sacrifient leur vie que pour une valeur qu’ils considèrent comme absolue. (De fait, il est indéniable que le noyau vital du communisme en Russie révèle des aspects religieux de plus en plus évidents.) De même l’Allemagne a succombé au nazisme, parce que les sociaux-démocrates allemands n’étaient pas prêts à mourir pour leur croyance en un idéal d’humanité. Quand l’humanisme se débat avec le problème de son propre avenir, il a besoin lui aussi de concepts religieux. Dans de telles situations, il a tendance à réactiver un système religieux avec une valeur absolue, fût-elle sous une forme cachée. L’immanence des événements de la vie amène l’homme à se poser des questions qui sont nécessairement religieuses (de quelque manière que nous les désignons) et qui dépassent sa propre existence pour exiger de lui un précieux sacrifice. Contre les arguments concernant la réaction religieuse, on remarquera que cette distinction n’est pas fondée sur une compréhension exacte. S’il est vrai qu’on a falsifié le vrai visage de la religion – les exemples historiques ne manquent pas –, cela ne veut pas dire qu’une telle falsification soit l’unique prérogative du domaine religieux. Toute valeur peut être falsifiée, et il ne faut pas oublier que des mouvements totalitaires ont brandi le drapeau du socialisme. De nos jours, la catastrophe morale de la falsification du socialisme doit nous servir de leçon. La falsification n’est pas inhérente à la nature d’une valeur ou d’une autre, mais à la forme externe dans laquelle elle s’incarne. Quand la valeur vise, dans une exigence de totalité, à la maîtrise et au contrôle de tout, c’est alors seulement qu’elle dévoile les aspects obscurs et corrompus de son apparence. Mais il y a aussi des exemples historiques opposés. Chaque religion officielle vit toujours des révolutions contre le courant dominant, et des hommes se battent pour le renouvellement de la religion quand sa forme est vidée de son contenu vivant et sain. Ceux qui comprennent l’histoire dans une véritable perspective sociologique en arrivent nécessairement à poser la religion comme une valeur progressiste, militante et purifiante. Même l’histoire juive n’est pas dénuée de ce noyau progressiste. Et si notre histoire est une histoire de vaincus, le regard de l’historien découvre, caché dans les documents religieux, un puissant courant révolutionnaire. Un désir révolutionnaire qui est lié par essence à une valeur suprême, et cette révolution est une révolution religieuse. Il semble que les événements de notre temps nous obligent une fois de plus à une compréhension plus juste de la signification des concepts religieux. Le massacre de la diaspora européenne est un événement sans précédent dans l’histoire juive. En fait, nous n’avons pas de concepts appropriés ou d’expression adéquate pour décrire ce qui se passe sous nos yeux. Les exemples du passé ne conviennent pas à la situation présente. La réponse de Bialik à la persécution des Juifs – «Dans la ville du massacre1» – ne nous satisfait pas et ne peut plus nous servir d’exemple. Ce problème nous force à réfléchir par nous-mêmes et à trouver nos propres solutions. La réponse à la question de «l’image de Dieu» ne peut plus être esquivée par la littérature ni par l’idéologie. L’explication sociologique ne répond pas au problème moral et humain du terrible massacre. Dès lors que nos yeux ont vu la crise et la grande destruction, nous ne pouvons plus revenir à une solution conventionnelle. L’incroyance ne se transmet pas en héritage. Nous ne pouvons pas dissimuler le problème religieux à nos enfants et à nos jeunes. Il n’est pas justifié de vouloir leur épargner une difficulté excessive et une grande souffrance en leur offrant la consolation du sécularisme. Un grand danger est lié à cette manière d’esquiver le problème religieux, car nous ne pouvons pas savoir de quelle manière il resurgira et comment il détruira l’esprit qui s’est donné des solutions faciles et s’est dérobé à une révolution religieuse. Le Socialisme moderne cherchait à fixer le cadre de la Révolution, convaincu qu’une période transitoire nous rapprochait d’elle. Cependant, l’histoire dans laquelle les hommes aspirent à leur rédemption – pour autant que l’âme humaine reste telle qu’elle est – ne connaît pas de telles périodes transitoires. À chaque moment de l’histoire l’homme peut réaliser la révolution de la rédemption et il doit même la réaliser, aussi longtemps que la religion constitue en lui une force vive.
|
|
|||
|
|
|