|
Gershom Scholem : Le prix d'Israël |
||
|
|
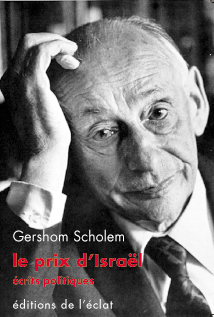 |
Note des éditeurs
Patricia Farazzi & Michel Valensi |
|||
|
« Que signifient aujourd’hui les constatations que j’ai faites hier? La même chose qu’hier. Elles sont vraies, si ce n’est que le sang coule goutte à goutte dans les rigoles creusées entre les grandes pierres de la Loi. » F. Kafka, Journal, 19 janvier 1922.
L’idée de ce livre est née au cours du travail d’édition du volume de David Biale, Gershom Scholem. Cabale et contre-histoire (IIe éd. 1982), paru aux Éditions de l’éclat en 2001. Les textes publiés ici pour la première fois en français (à l’exception de «Sur notre langue»), ont été traduits à partir de leur version originale, en allemand, anglais ou hébreu. «Mouvement de jeunesse juif», «Adieu», «Discours sur Israël», «Israël et la Diaspora» ont été traduits de l’allemand par Marc B. de Launay. «Sur notre langue. Une confession», a été traduit de l’allemand et présenté par Stéphane Mosès. «Qui est juif?» et «Qu’est-ce que le judaïsme?» ont été traduits de l’anglais par Patricia Farazzi. Les articles des années 1929-1931 et l’essai «Mémoire et utopie dans l’histoire juive» ont été traduits de l’hébreu par Yaïr Or et les éditeurs. Denis Charbit (éditeur du volume Sionismes. Textes fondamentaux, Albin-Michel, Paris, 1998) a mis à notre disposition une traduction antérieure de l’article «Qui sont les diviseurs ?» par Tsvi Lévy, qui nous a été fort utile. L’ensemble des traductions a été revu par les éditeurs. Ces quelques notes introductives suivent la chronologie des textes de Scholem choisis pour ce volume. Une notice biographique, en parallèle avec les événements les plus marquants de l’histoire du sionisme et de l’État d’Israël, ouvre l’ensemble, et permettra au lecteur de mieux situer les débats dont il sera question ici. Un glossaire regroupant les définitions d’un certain nombre de termes et les biographies sommaires des personnalités évoquées figure en fin de volume. Gershom Scholem est mort à Jérusalem en 1982, laissant une œuvre immense dans le domaine de la mystique juive et de la Kabbale, dont la publication, volume après volume, n’épuise pas le secret. Une autre partie de ses écrits, intimement mêlée à la première, concerne ses engagements sionistes. Ils prirent au fil des ans des formes diverses, mais n’en restèrent pas moins toujours fidèles à une définition du sionisme comme un «retour utopique des Juifs à leurs propre histoire» (infra, p. 115 et passim), et à une conviction, dont il fit part à son ami Walter Benjamin dans une célèbre lettre de juillet 1931: «Ce qui a toujours été et reste évident pour moi, c’est simplement le fait que la Palestine est nécessaire, et cela me suffisait1» (infra, p. 48). |
1. « Mir war und ist nur von jeher klar gewesen, dass Palästina notwendig ist.» Le terme Palestine désigne ici, faut-il le préciser, la Palestine mandataire et, d’une manière plus générale, l’entreprise sioniste. Nous avons traduit «Palestine», «Eretz-Israël» ou «Sion», en respectant l’expression qu’utilise Scholem selon les occasions.
|
|||
|
Nous avons rassemblé ici quatorze essais (lettres, articles ou conférences) dressant à grands traits le portrait d’un «Scholem politique», depuis ses prises de position contre le «sionisme en chambre» des mouvements de jeunesse juifs dans l’Allemagne du début du vingtième siècle, jusqu’à celles des années 1970 en faveur d’un judaïsme conçu comme «organisme vivant», et donc propre à une perpétuelle reviviscence. Itinéraire de Berlin à Jérusalem, ponctué toujours par une cohérence des actes et des paroles, qui le rend exemplaire.
Berlin
Le Scholem berlinois est un «anarchiste asocial» (Fidélité et Utopie, p. 28). Il conteste toute forme d’autorité: paternelle, scolaire ou nationale, et ses prises de position contre la guerre lui vaudront d’être renvoyé à la fois du domicile familial et de l’école, et de rompre radicalement avec la plupart des mouvements de jeunesse juifs vers lesquels nombre de ses amis se dirigeaient alors [texte 1]. Le 4 janvier 1915, il note dans son journal: «Notre objectif principal: Révolution! Révolution totale! Nous ne voulons ni réformes, ni accommodement, nous voulons la révolution et le renouvellement, nous voulons incorporer la révolution dans notre constitution. Révolution interne et externe. Contre la famille, contre la maison paternelle... Mais surtout, nous voulons la révolution dans le judaïsme. Nous voulons révolutionner le sionisme et prêcher l’anarchie, qui signifie l’absence de domination.» Le mouvement vers Sion et l’apprentissage de l’hébreu («jusqu’à quinze heures par semaine !», De Berlin à Jérusalem, p. 86) lui semblent alors les seules alternatives. Et s’il collabore à la revue de Martin Buber, Der Jude, s’il milite au sein du groupe «Jeune Judée», et se lie d’une amitié profonde avec Walter Benjamin, l’Europe en guerre peu à peu s’éloigne de ses préoccupations essentielles et il se prépare au voyage : «La voie de Sion passe-t-elle par les capitales de l’Europe? […] Nous voulons tracer une frontière entre l’Europe et la Judée: ma pensée n’est pas votre pensée, ma voie n’est pas votre voie. Nous n’avons pas tant de gens que cela à vous donner en offrande pour que vous les jetiez dans la fournaise, tel Moloch. Non, nous avons besoin d’hommes ayant le courage d’avoir des pensées juives qui soient leurs pensées finales, ayant le courage de penser et d’agir radicalement, d’être proches de leur peuple afin de ne pas se laisser vaincre par la désinformation, de Londres à Saint-Pétersbourg – des hommes que les mots “dogmatisme ” et “trahison” font éclater de rire.» («Sermon Laïque», Die Blauweisse Brille, 2, 1915 [cité dans Biale, p. 38]). Ainsi l’«Adieu» [texte 2] qu’il signe trois ans plus tard, est à la fois un détachement à l’égard d’une forme de pratique politique désuète à ses yeux, mais également d’une condition et d’un continent qui lui sont désormais étrangers. La «voie de Sion» s’ouvre alors, et le 14 septembre 1923, Scholem s’embarque à partir de Trieste pour la Palestine. Jérusalem
Scholem est à Jérusalem. Mais le chemin pour parvenir à l’image qu’il pouvait s’en faire depuis la diaspora est autrement difficile. Le paradoxe de son sionisme semble tenir dans cette phrase de Kafka: «Il y a un but, mais il n’y a pas de chemin. Ce que nous nommons chemin est notre hésitation» (Journal, 18.11.1917). Sa voix, alors, singulière, s’efforce de dire l’«hésitation», quand d’autres pensent que désormais le «but final» est atteint. Les articles de 1929 à 1931 [textes 3 à 8], témoignent ainsi de son activité au sein du groupe Brit Shalom, et d’une prise de conscience des contradictions internes du mouvement sioniste, en même temps que des conflits qui l’opposent aux révisionnistes de Jabotinsky ou aux socialistes du Mapaï. L’anarchiste berlinois devient dialecticien eretz-israélien. «Il n’y a pas au monde d’exemple plus instructif pour la dialectique propre à tout processus historique que l’histoire du sionisme» écrit-il dans une note inédite (infra, p. 44). «Ce n’est que peu à peu que la dialectique s’est imposée à moi, par sens du réel, en particulier après mon arrivée en Eretz-Israël, lorsque je constatais les contradictions inhérentes au processus d’édification de la nouvelle société. [...] Je n’ai pas appris la dialectique chez Hegel ou chez les marxistes, mais à partir de mes propres expériences et de ma réflexion sur les complexités du sionisme dans sa phase de réalisation» (Fidélité et utopie, p. 57). Mais outre les combats politiques en faveur d’un dialogue juif-arabe, d’un état bi-national ou d’une nouvelle définition du sionisme, se pose également la question des fondements de cette nouvelle société, en particulier du rôle de l’hébreu, déjà évoqué dans les textes berlinois (infra, p. 28, 35) et qui revient alors avec d’autant plus de force. Le problème de la sécularisation de la langue sacrée prendrait un tour quasi apocalyptique si, justement, la «dialectique de la révolte et de la continuité» ne jouait pas ici aussi son rôle. On ne peut nier, dans cette perspective, que la lettre à Rosenzweig [texte 9], «À propos de notre langue» de 1926, témoigne d’un véritable désespoir. Mais «ce désespoir, qui n’est rien d’autre que la prise de conscience de notre véritable situation, nous stimule et peut devenir une source de nouvelles énergies positives», écrit-il en 1931 (infra, p. 71): il pourrait indiquer la distance qu’il nous faut parcourir pour parvenir à le dépasser, pour espérer encore. Scholem parcourra cette distance en silence et dans la solitude. Silence et solitude sur lesquels se fondent, pour lui, la vraie communauté. N’avait-il pas déjà écrit, dès 1918: «La communauté veut la solitude: non pas la possibilité de vouloir tous ensemble la même chose, mais seule la solitude commune fonde la communauté. Sion, la source de notre peuple est la solitude commune, voire, en un sens extraordinaire, identique à tous les Juifs, et l’affirmation religieuse du sionisme n’est autre que celle-ci: le centre de la solitude est en même temps précisément le lieu où tous se retrouvent, et il ne saurait y avoir d’autre endroit pour une telle rencontre.» (infra, p. 33)? Étrange vision du politique, à l’heure de la célébration du nombre, en toutes parts de ce monde. Ce qui fit dire à Rosenzweig dans une lettre à Rudolf Hallo: «[Scholem] est réellement sans dogme. Il est absolument impossible de l’endoctriner. Je n’ai jamais rien vu de pareil chez les Juifs occidentaux. Il est peut-être le seul qui soit vraiment rentré au foyer. Mais il y est rentré tout seul.» (Cité dans Biale, p. 63). Toutes ces années qui précèdent la guerre sont pourtant des années de travail intense, traversées par de nombreuses crises de toutes sortes. La révolte arabe de 1936, en particulier, qui compromettra pour de très longues années toute nouvelle tentative de rapprochement entre les deux peuples, est une terrible désillusion. Scholem s’en confie à Benjamin dans une lettre du 6 juin 1936, livrant une analyse de la situation politique qui n’est pas sans faire frémir le lecteur du début du vingt-et-unième siècle: «Depuis plusieurs semaines, et avec une violence toujours croissante, les Arabes mènent une véritable guerre de résistance, qui révèle une puissance inattendue – et prend des aspects de guerre terroriste et barbare. Il est vrai que la grève générale des villes arabes est imposée aux Arabes eux-mêmes par une terreur interne, comme l’est également son financement, mais le fait même qu’elle est un succès, et que ses adversaires ne parviennent pas à l’enrayer, témoigne d’une forte discipline. Dans la mesure où les Juifs – au lieu de répondre par une contre-terreur, comme il serait facile de le faire – ont fait preuve d’une retenue étonnamment disciplinée, qui constitue un succès d’ordre moral, ils ont jusqu’à présent conservé une position très forte dans la sphère politique. Si les Juifs ou les groupes de Juifs ne perdent pas le contrôle de leurs propres nerfs – ce qui est évidemment l’objectif de ces nombreux actes de terrorisme et de sabotage – on ne voit pas comment les Arabes pourront tirer le moindre avantage de cette politique de terreur. D’un autre côté, il est évident qu’ils ne savent pas comment sortir d’une aventure qui a certainement été entreprise dans l’espoir de pouvoir contraindre le gouvernement anglais, avec des méthodes un peu trop orientales, à stopper l’émigration juive. Jusqu’à présent, ce calcul est totalement erroné, et le gouvernement a maintenu un comportement décidément inflexible. Il est vrai qu’en fin de compte, il se peut que ce soit nous qui ayons à en payer le prix.» Trois ans plus tard, le second conflit mondial portera à son comble l’horreur et le désespoir du peuple juif. Le frère aîné de Scholem, Werner, ancien député communiste au Reichstag, déporté à Dachau depuis 1935, est assassiné au camp de Buchenwald en 1940. Ses deux autres frères et sa mère émigrent en Australie. Walter Benjamin se suicide à la frontière entre la France et l’Espagne. Six longues années du court vingtième siècle. Le 8 mai 1945, depuis Jérusalem, Scholem écrit à son ami Shalom Spiegel : «Je suis seul à la maison. Je repense à ces six dernières années, qui se sont abattues sur nous comme un véritable ouragan, semant la plus totale dévastation. Il est difficile de saluer cette victoire avec un sentiment de jubilation, car si tous les autres ont gagné, nous seuls avons perdu. Et en ce jour d’inventaire, une foule infinie de pensées amères se tournent vers nous et vers les autres. Mais malgré tout, un élément tout à la fois nouveau et ancien s’est fait jour. Une chose est sûre, le Messie n’est pas venu et le monde continue de tourner comme à son habitude.» (A Life in Letters, p. 324) Le monde continue de tourner comme à son habitude et, en janvier 1946, Scholem écrit : «D’un point de vue strictement humain, je crois à la durée “éternelle” de l’antisémitisme: les analyses pourtant très intelligentes de ses nouveaux fondements contemporains ne l’empêchent pas de réapparaître dans de nouvelles constellations [...] Le problème de l’État m’est complètement égal, car je ne crois pas que le renouvellement du peuple juif dépende de la question de son organisation politique, mais plutôt de son organisation sociale. Ma croyance politique est – si elle est quelque chose – anarchiste1.» La conférence «Mémoire et utopie dans l’histoire juive» [texte 10], où les thèmes benjaminiens de l’histoire affleurent de manière évidente, tout comme l’empreinte du Nietzsche de la Deuxième considération inactuelle, qui a écrit: «Il est impossible de vivre sans oubli», date de cette même année. Il est vrai qu’en 1946, la mémoire des Juifs en Eretz-Israël, s’emplit jour après jour du souvenir dramatique de ceux des leurs qui furent assassinés en diaspora. Comment donner «une place et un nom» à chacun? Comment assurer la continuité historique des générations? Comment enseigner cette histoire à laquelle on revient dans le cadre très pratique d’une éducation (bientôt) nationale? Telles sont les questions abordées dans ce texte central. Mais ce «retour des Juifs à leur propre histoire» ne signifie pas, pour Scholem, qu’ils y entrent en renonçant à ce qui faisait d’eux «un peuple pas comme les autres». S’ouvre alors un débat, qui n’est toujours pas refermé en Israël, concernant l’enseignement des matières religieuses au sein d’un système éducatif laïc. Ne serait-ce pas l’enjeu de cette société nouvelle que la question puisse se poser encore? Pour Scholem, elle est primordiale, et... «ne nous rendra pas orthodoxes pour autant» (infra, p. 106).
|
1. Dans une lettre véhémente à Hannah Arendt du 28 janvier 1946. En réponse à l'article d'Arendt «Réexamen du sionisme». La lettre et l'article d'Arendt sont traduits dans Sionismes.
|
|||
|
Le prix d’Israël Le 14 mai 1948, est proclamée la création de l’État d’Israël. Le pays affronte alors plusieurs guerres successives et y répond victorieusement. «Notre peuple a montré qu’il savait combattre. Mais quel triste monde que celui où pareille démonstration nous a valu plus de respect et plus de considération que l’exercice de ces vertus pacifiques pour la maîtrise desquelles on a appelé à fonder l’État juif» (infra, p. 117). Les conférences de 1967 et 1969 [textes 11 et 12] nous incitent à justifier le titre de ce volume : Le prix d’Israël. Nous avions bien conscience qu’il ne pouvait, dans son équivoque volontaire, rendre compte de la complexité des positions de Scholem. Il n’en reste pas moins que c’est une notion qui revient comme un leitmotiv dans les textes publiés ici (p. 49, 90, 93, 97, 105, 116, 138, 159), comme dans toute son œuvre, même si, à Ehud Ben Ezer qui l’interroge en 1970, Scholem répond : «Vous me demandez quel est le prix du sionisme, alors que la vraie question n’est pas le prix du sionisme, mais le prix de l’exil.» Il ne fait pas de doute, pourtant, que lui-même, comme tous ceux qui firent le voyage depuis les différents rivages de la diaspora vers la terre d’Israël, avant ou après la guerre, eurent à payer le plus souvent et l’un et l’autre. Se pourrait-il alors que le «prix d’Israël» soit celui, aussi, de la liberté d’être, pour chacun, pleinement dans sa propre histoire, comme a pu l’écrire récemment, bien que dans un tout autre contexte, Eric Marty : «Au fond pourquoi ne pas le dire? si nous avions ce sentiment intense que c’était notre liberté qui était en jeu, c’est aussi parce qu’il s’agissait d’Israël. Bien que non-juif, il nous semblait donc qu’atteindre Israël dans son être même, c’était atteindre notre liberté. C’est donc peut-être qu’Israël était notre liberté» (Bref séjour à Jérusalem, Paris, Gallimard, 2003, p. 29)? Un telle prise de conscience partagée donnerait alors toute leur dimension aux paroles qui concluent la conférence de 1967 : «En Israël, nous ne doutons pas que les vertus de la paix seront plus fortes et, finalement, plus décisives que celles dont on a dû faire preuve dans ce combat qui nous a été imposé. Sans doute s’agit-il au fond des mêmes vertus, mais obéissant seulement à des configurations et des concentrations différentes. Israël a montré qu’il était prêt à se mobiliser pour sa cause; espérons qu’il nous sera accordé de nous mobiliser pour elle dans la paix plutôt que dans la guerre» (infra, p. 117). Il suffirait de trouver des oreilles qui entendent.
«Qui est juif?» C’est au terme d’un long parcours de questions que reviennent celles, fondamentales, qui consistent à définir «qui est Juif ?» et «qu’est-ce que le judaïsme ?» [textes 13 et 14]. Ces conférences des années soixante-dix ont un cadre précis, quasi constitutionnel pour le premier, puisqu’elles participent d’un débat général en Israël, qui doit permettre de statuer une nouvelle fois sur la question du droit au retour des Juifs sur la terre de leurs ancêtres, et de la formation d’une société pluraliste et laïque, alimentée néanmoins – on devrait dire «néanplus» – par des sources religieuses. Il n’est pas inutile de rappeler d’ailleurs que ces définitions évoluèrent avec les différents parlements. Au «mur de pierre de la Loi 1» auquel se heurte toute volonté, non pas de réformer ou d’assouplir les règles qui définissent le Juif et le judaïsme, mais simplement celle de lui conserver sa propre vitalité interne, Scholem substitue une «transparence de la Loi», en tant qu’elle n’est qu’une «ombre projetée par Dieu sur le monde», permettant à tout homme décidé et responsable de s’y abriter. Le Cantique des Cantiques (2:3) ne dit-il pas : «À son ombre j’ai désiré m’asseoir»? Le judaïsme serait alors cette porte que «nul autre que celui qui en franchit le seuil ne pourrait ouvrir, puisqu’elle n’est faite que pour lui». Contrairement au paysan de Kafka, le Juif ne reste pas «devant la Loi» jusqu’à en mourir. Et quand on sait l’importance que Scholem pouvait accorder à l’œuvre de Kafka, au point de la considérer, par certains aspects, comme proprement kabbalistique, on ne peut s’empêcher de considérer sa définition d’un judaïsme en tant qu’«organisme vivant» comme également kabbalistique, d’autant que le terme est emprunté à la Kabbale d’Isaac Louria. L’œuvre tout entière de Scholem se concentre alors et revient à ce pan de la culture des Juifs que des siècles de diaspora avaient tenu secret, et néanmoins conservé: cette Kabbale, à laquelle il consacra sa vie. Le retour des Juifs à leur propre histoire permettait dès lors qu’elle vienne à la lumière, même si le Scholem «matérialiste mystique à tendance dialectique», ne pouvait s’empêcher de déclarer que «publier les œuvres maîtresses de l’ancienne littérature cabalistique est la meilleure garantie de son secret». Ce qu’il fit sans relâche, jusqu’à ce jour de février 1982, avant d’aller reposer au cimetière de Sanhédria à Jérusalem, où, à gauche en entrant, et en suivant l’allée qui longe le mur d’enceinte, on peut trouver sa tombe, sur la gauche, dans la première rangée, à environ cent mètres du début de l’allée.
Tel Aviv, septembre 2003/eloul 5763. |
|
|||
|
|
|